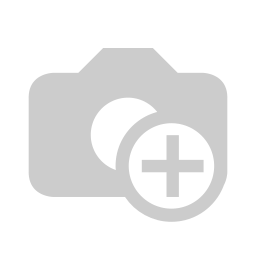.png?access_token=d3816c73-9996-4f8a-9554-48bc97653669)
Impossible d’y échapper : depuis le début de cette année, les articles, posts, interviews… concernant le ChatGPT fleurissent de toute part. Dès lors, chez SynHERA aussi, nous avons voulu en savoir plus sur ce fameux robot conversationnel. Alors, cet outil est-il synonyme de danger ou d’opportunité pour les enseignants-chercheurs de notre réseau ? On en parle avec Yves Laccroix, conseiller numérique, et Aubin de Perthuis, juriste, chez SynHERA.
Yves, Aubin, quelles ont été vos réactions en tant que conseiller numérique et juriste lorsque vous avez découvert le ChatGPT ?
Yves : "Au départ, j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un outil très sympa. Évidemment, j’ai voulu le tester, et là je me suis rendu compte que malgré son côté attractif, il possédait de nombreuses limites. Par exemple, il y a une manière spécifique de l’utiliser, il faut, notamment, contextualiser un maximum sa demande si on veut obtenir du contenu pertinent. Cependant, pour certaines tâches, il s’agit, effectivement, d’une plateforme qui peut s’avérer utile".
Aubin : "J’ai découvert ChatGPT fin décembre. Et même si je ne fais pas partie de ses utilisateurs, j’ai souhaité me renseigner à son sujet, notamment à travers la lecture de plusieurs articles qui en parlent sous l’angle de la propriété intellectuelle".
Pour les chercheurs de notre réseau, est-ce que cet outil peut les aider dans leurs démarches scientifiques ?
Yves : "Il peut être utile pour le côté rédactionnel. Par exemple, pour réécrire certains passages ou pour traduire un texte en écriture inclusive. Il peut aussi donner de l’inspiration, même s’il faut vraiment faire preuve de prudence puisqu’on ne connaît pas les sources utilisées. Rappelons qu’à partir du moment où des informations se trouvent sur le net avant 2021, elles sont susceptibles d’être exploitées par le ChatGPT. Il peut donc générer du contenu avec des renseignements trouvés, par exemple, sur Wikipédia, ou d’autres sites pas toujours fiables…"
Aubin : "Nos chercheurs étant, pour la majorité, également enseignants, je pense que l’impact sera davantage important sur l’aspect académique. Marc Romainville, professeur à l’UNamur, a dit lors d’une interview à la RTBF, je cite : « Il faut voir ChatGPT comme une opportunité, celle de revoir les méthodes d’évaluation et de s’éloigner de la simple restitution pour les étudiants, en leur demandant de faire preuve de plus de créativité ». Selon moi, le problème se situe surtout au niveau de la formation des enseignants à ce nouvel outil, et plus généralement aux outils numériques. Heureusement, plusieurs guides peuvent les outiller comme le « Guide de l'enseignant : L'usage de ChatGPT, « ce qui marche le mieux » » consultable ICI "
Et au niveau de la propriété intellectuelle, quels sont les dangers de cet outil ?
Aubin : "Il existe encore de nombreuses interrogations par rapport à l’impact de l’intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle. Tout d’abord, la qualité d'auteur est réservée aux personnes physiques, ce qui n’est pas le cas de notre robot. Ensuite, il est difficile de considérer le résultat généré par Chat GPT comme une œuvre originale exprimant des choix libres et créatifs et portant l'empreinte d’une personnalité. Par contre, pour générer ce contenu ChatGPT peut utiliser des œuvres qui, elles, peuvent être protégées par le droit d’auteur, et ce sans autorisation préalable et sans citer la source. La difficulté est d'identifier s'il s'agit d'un contenu produit par ChatGPT ou s'il s'agit de la reproduction de l'œuvre d'un tiers. C’est là que les choses se compliquent…"
De nouvelles formations avancées sont proposées par SynHERA. Pensez-vous qu’il est pertinent pour notre structure d’intégrer cette plateforme à celles-ci afin d’outiller nos membres quant à l’utilisation de ce robot conversationnel ?
Yves : "Selon moi, il faut juste faire passer le message que le ChatGPT est comme une recherche Google : si on ne croise pas ses résultats avec d’autres outils, ce n’est pas productif. Il faudra également attirer leur attention quant aux dangers liés au non-respect de la propriété intellectuelle".
Pour certains spécialistes, le ChatGPT est, sans conteste, l’innovation de l’année, et l’intelligence artificielle est devenue un outil incontournable pour les entreprises qui se situent dans une démarche d’innovation. Les scientifiques de notre réseau ont-ils déjà pris ce train en marche ?
Yves : "Oui et d’ailleurs pour les scientifiques avec des expertises en informatique, l’intelligence artificielle n’a rien de nouveau. Ils sont déjà formés à celle-ci. D’ailleurs, on la retrouve dans plusieurs projets de recherche du réseau SynHERA et il y a de plus en plus d’appels à projets qui y sont liés".
Aubin : "Comme l'a dit Yves, le ChatGPT n’a rien de nouveau pour les scientifiques et c’est surtout une nouveauté pour les enseignant.e.s, hors sciences de l’informatique".
Yves : "Nous savons aussi que ce courant va encore fortement évoluer avec d’autres grosses entreprises qui vont lancer leurs solutions pour concurrencer le ChatGPT. L’intelligence artificielle risque donc d’être encore longtemps au centre de toutes les attentions".
Le poème du ChatGPT
Impossible de faire un article sur ChatGPT, sans laisser la parole au principal concerné. Nous avons donc demandé à Chat GPT de nous écrire un poème sur SynHERA. Qu’en pensez-vous ? Plutôt étonnant non ?
SynHERA, oh SynHERA
Guide des chercheurs passionnés,
Pour leurs projets en panne d’air,
Leur donne des ailes pour s’envoler.
La Haute École, son partenaire,
L’union fait la force pour innover,
Leurs idées, ils peuvent les partager,
Avec SynHERA pour les aider.
De la recherche à l’entreprise,
Ils se lancent avec audace,
SynHERA est leur alliée,
Pour concrétiser leurs belles idées.
SynHERA, oh SynHERA,
Un tremplin pour la créativité,
Aux chercheurs, elle offre un miroir,
Où leur talent peut briller en vérité.
ChatGPT
5 questions sur le Chat GPT